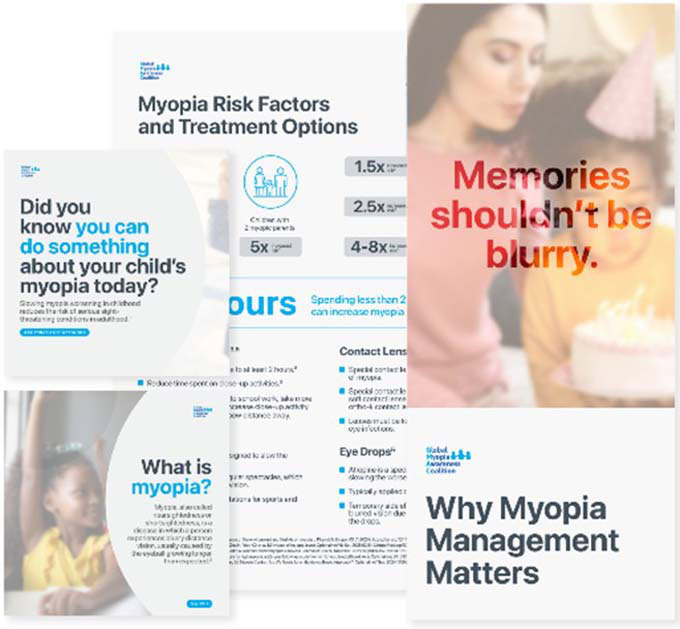Le nombre de cabinets et de magasins spécialisés en vision binoculaire a doublé en Suisse
Améliorer les soins optométriques pour les personnes souffrant de problèmes binoculaires est un objectif ambitieux.

Objectif
Dans l'idéal, la population serait sensibilisée au fait qu'il faut se rendre à un examen ophtalmologique optométrique lorsque des problèmes de vue surviennent, par exemple sur le lieu de travail. Les parents sauraient à qui s'adresser lorsque leurs enfants scolarisés rencontrent des problèmes de lecture inattendus et des maux de tête liés à la vue. La réalité est actuellement différente. De nombreuses personnes concernées ne savent pas encore qu'elles ou leurs enfants peuvent éventuellement être aidés. Ou alors, elles considèrent leurs problèmes comme normaux et ne peuvent pas imaginer qu'une autre et meilleure qualité de vision serait possible. Les possibilités offertes par l'optométrie de soutenir les performances de l'accommodation et de la coopération binoculaire au moyen de la correction de lunettes, de l'entraînement visuel ou de lentilles de contact afin de réduire le stress visuel ne sont pas encore suffisamment connues. Les problèmes de vision dont il est question ici ne sont pas causés par des maladies, des allergies ou par le strabisme ou l'amblyopie, mais surviennent chez 30 % des personnes ayant des yeux sains.
Même si l'optométrie était déjà complètement établie comme première adresse pour les problèmes de vision, un autre défi entre en jeu : actuellement, aucun approvisionnement généralisé en cabinets ou magasins spécialisés dans la résolution de problèmes binoculaires n'est assuré en Suisse.
Il en résulte donc deux tâches concrètes qu'il convient d'aborder l'une après l'autre :
- Augmenter le nombre de cabinets et de magasins spécialisés en tant qu'interlocuteurs pour les problèmes binoculaires par le biais de formations et de formations continues, afin de garantir l'accès à des soins de qualité en Suisse.
- Informer le public sur la fréquence des problèmes de vue chez les enfants d'âge scolaire (et les adultes) et le sensibiliser aux possibilités offertes par l'optométrie.
La première tâche est déjà en cours depuis deux ans, depuis qu'une "table ronde sur la vision binoculaire" a été mise en place sous forme de réunion zoom. Parallèlement, une offre de formation continue régulière sur des thèmes binoculaires a été mise en place à l'Institut d'optométrie, qui se consacrera principalement au thème BTSO à partir de 2024 : www.btso.ch.
La deuxième tâche ne peut pas être réalisée par un seul institut de la FHNW, mais nécessite une bonne coopération entre de nombreuses organisations professionnelles et de formation continue dans le domaine de l'optique et de l'optométrie et au-delà. Si l'on parvenait à financer une étude à grande échelle pour déterminer les fréquences du stress visuel chez les écoliers du primaire en Suisse, cela permettrait de consolider les contacts avec les écoles et de préparer une campagne d'information du public. Comme le bien-être des enfants scolarisés tient à cœur à de nombreuses personnes, elles se laisseront certainement enthousiasmer par ce sujet.
Antécédents
En 2018, un projet a été lancé sous la direction du professeur Roger Crelier et du professeur Dr Stephanie Jainta, qui devait faire avancer la formation dans la filière optométrie et avoir en outre une portée pour la profession en Suisse. Le domaine de la vision binoculaire a été choisi pour ce projet, notamment en raison de l'expertise particulière du personnel de l'Institut d'optométrie d'Olten. L'équipe disposait d'une liste considérable de publications sur des sujets tels que l'eye-tracking binoculaire, la recherche en lecture et l'application de méthodes binoculaires. Le projet, baptisé "Binokulare Testsequenz Olten" (BTSO), a été soutenu par la fondation OptiqueSuisse jusqu'au début de l'année 2025 et a connu différentes phases de projet. Dès le début, les objectifs étaient les suivants
- Aperçu et analyse des modèles existants qui servent de base à une nouvelle séquence de tests binoculaires.
- Mise en évidence des paramètres binoculaires décisifs en dialogue avec l'ophtalmologie, l'orthoptie et l'optométrie/optique, sur lesquels la nouvelle séquence sera basée ; pour ce faire, des ateliers/conférences seront organisés à l'IO et des experts externes ciblés issus des différents groupes professionnels seront invités afin d'élargir l'équipe à l'Institut d'optométrie.
- Développement de dispositifs de mesure et de test correspondants.
- Développer une approche vérifiée (evidence based) et séquencée pour déterminer l'état binoculaire afin de définir une correction ou une intervention binoculaire.
- Les formes de test et les procédures sont décrites de manière claire, détaillée et compréhensible.
- En cas d'utilisation et de procédure appropriées, la mention " ... testé selon BTSO ... " peut être utilisée.
- Un essai clinique systématique et multicentrique de la procédure sera ensuite réalisé.
Plusieurs rencontres avec des spécialistes de différents groupes professionnels ont eu lieu au cours des premières années du projet, afin de sonder les points de recoupement et les points de complémentarité. Le point de vue extérieur a été particulièrement précieux pour élargir son propre horizon. La recherche bibliographique a été particulièrement intensive : Les connaissances ont été collectées et partagées lors de réunions hebdomadaires de l'équipe, qui comptait alors six personnes à l'institut. L'ouvrage spécialisé "Perceiving in depth" (HOWARD, 2012) a occupé une place centrale pendant toute une année. Ensuite, les recherches ont été étendues à l'état actuel des études. Avec l'ouvrage "Clinical Management of Binocular Vision" (SCHEIMAN ; WICK, 2020), un autre livre spécialisé a été un guide important pendant toute la durée du projet. Les formations et la pratique clinique de l'optométrie dans le monde entier, sur tous les continents, ont été influencées par le contenu de ce livre.
Au cours de la deuxième et de la troisième année du projet, la faisabilité d'un appareil de mesure objectif des mouvements oculaires, des plus petits aux plus grands, a été étudiée au moyen d'un opthalmoscope à balayage laser (SLO). En collaboration avec le "Laboratory for Development of Lasers and Optical Systems FHNW" à Windisch et des experts de premier plan à Bonn et Erlangen (Allemagne), un modèle de construction a été réalisé, permettant de visualiser également des structures au centre de la rétine. Fin 2021, d'importantes connaissances sur la faisabilité de principe ont été générées, mais le plus grand défi résidait dans le centrage binoculaire stable des yeux des patients. Il serait certes techniquement possible que les patients portent des ballasts ou des verres de lunettes lors d'une mesure, mais l'endroit exact de l'observation devrait être maintenu avec une extrême précision. Dans la pratique, il serait donc nécessaire de fixer si fortement les patients devant l'appareil que même les plus petits mouvements de la tête seraient rendus impossibles. Finalement, cette voie de développement d'une séquence de mesure objective a été abandonnée en raison des coûts de développement élevés auxquels il fallait s'attendre.
Développement d'une application d'apprentissage
A partir de 2021, les connaissances et expériences disponibles ont été résumées et réévaluées. Ce fut le véritable début de la séquence de tests BTSO, désormais bien connue. Outre d'autres publications, l'impulsion déterminante est venue d'une série d'études publiées sous le nom de "BAND 1-3" (HUSSAINDEEN 2017-2018). Dès le début, il s'agissait de développer une batterie de tests simples et peu coûteux pour les anomalies accommodatives et binoculaires. Pour ce faire, les valeurs normatives complètes des principales mesures ont été déterminées dans le TOME 1, composé de cinq tests accommodatifs et de onze tests binoculaires. 920 écoliers du sud de l'Inde âgés de 6 à 17 ans ont été examinés, pour moitié en milieu urbain et pour moitié en milieu rural. Le TOME 2 a analysé la fréquence et la répartition des classes non strabiques (HUSSAINDEEN ; RAKSHIT ; et al., 2017). La classification qui y a été utilisée s'inspirait étroitement de l'"analyse intégrative" établie de Scheiman et Wick. Des anomalies ont été constatées chez 30 % des enfants examinés (n=283). La batterie minimale de tests est le résultat des analyses de l'étude BAND 3 (HUSSAINDEEN ; RAKSHIT et al., 2018). La précision des tests individuels et des combinaisons de tests a été examinée. L'objectif était de déterminer le test le plus efficace ou la batterie de tests la plus efficace. Cette batterie de tests a été optimisée pour les classes les plus fréquentes : l'insuffisance de convergence et l'inflexibilité de l'accommodation.
Sur la base de ces études, la voie à suivre pour le BTSO a été repensée. L'un des avantages de cette batterie de tests minimale est qu'elle peut être utilisée pour des dépistages par des professionnels et des amateurs d'optométrie. Si un écolier ou un adulte présente un test anormal lors du dépistage, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une anomalie accommodative ou binoculaire. Ce résultat conduirait alors à une orientation vers un examen optométrique différencié.
Les quelques tests de la batterie minimale de tests fournissent en outre une contribution importante aux données permettant de déterminer l'état binoculaire. Les 9 principales classes binoculaires et accommodatives sont les suivantes : Insuffisance de convergence et de divergence, Excès de convergence et de divergence, Eso et exophorie de base, Insuffisance, excès et inflexibilité de l'accommodation. Pour déterminer leur statut, on procède généralement à un regroupement à partir de l'abondance des données. Il existe des signes principaux, qui doivent toujours être présents, et des signes secondaires, qui doivent étayer le résultat. Dans les 9 classes, les données des tests minimaux font partie des signes principaux. Ainsi, l'équipe BTSO s'est demandé si la batterie de tests minimaux ne permettait pas de dépister seulement quelques classes, mais si toutes les 9 classes importantes pouvaient être trouvées par ce biais lors du dépistage. Une phase de développement passionnante a commencé, au cours de laquelle une logique de décision a été développée afin de pouvoir programmer une application. Un partenaire externe spécialisé dans le développement de logiciels a été trouvé afin de viser une solution professionnelle dès le début. Le développement ultérieur d'une application d'apprentissage basée sur le web a créé une des conditions les plus importantes pour aborder le premier objectif : Faciliter l'accès ou le retour des professionnels au monde de la vision binoculaire et pouvoir ainsi améliorer la situation des soins en Suisse. L'importance de proposer un outil d'aide lorsque des incertitudes subsistent sur le sujet s'est révélée lors d'une enquête menée auprès des étudiants au cours du semestre de fin d'études. Même si un spécialiste se lance dans la pratique avec une bonne formation, il a idéalement besoin d'un environnement dans lequel les examens binoculaires sont déjà établis. Souvent, ce n'est pas le cas et il a été dit à plusieurs reprises que sans aide pratique, il existe une trop grande incertitude pour travailler seul dans ce domaine.
Pour le semestre d'automne 2023, l'application d'apprentissage BTSO a été introduite à l'Institut d'optométrie dans le module "Vision binoculaire 1". Tous les étudiants y auront un accès libre à l'application d'apprentissage et pourront également utiliser les tests et les évaluations dans le cadre du "stage clinique en optométrie". Une offre de formation continue régulière a été mise en place à l'institut pour tous les professionnels intéressés par l'analyse et la correction binoculaires. Au moins la participation à un cours de formation continue a été définie comme obligatoire pour pouvoir débloquer l'application. Cela doit permettre de garantir la qualité professionnelle des utilisateurs de BTSO. En outre, des rencontres en ligne sur la vision binoculaire sont proposées, auxquelles des invitations sont régulièrement envoyées. Même si l'objectif d'une prise en charge généralisée est encore loin d'être atteint, de beaux succès se dessinent : ainsi, en l'espace d'un an, on a réussi à doubler le nombre estimé de cabinets et de magasins en Suisse spécialisés dans la vision binoculaire.

Études BTSO sur des adultes
Une partie des objectifs du projet était d'étudier la séquence de test nouvellement définie. Pour ce faire, deux études multicentriques (quatre centres en Suisse alémanique) ont été menées sur 150 personnes chacune, âgées de 18 à 38 ans, dont 100 souffraient de troubles visuels et 50 n'en souffraient pas. L'étude de validation compare les résultats de l'analyse complète établie de l'état binoculaire avec ceux de l'application d'apprentissage BTSO. L'étude sur l'anamnèse recherche des concordances entre les questions de l'anamnèse nouvellement développée et les mesures fonctionnelles remarquables. Les études ne sont pas encore terminées, mais toutes les mesures des sujets ont été achevées. Le temps nécessaire s'est avéré nettement plus important que ce qui était prévisible au départ. En raison de la maladie de l'équipe, l'évaluation a en outre été fortement retardée. La sélection des sujets a également été très exigeante, car des critères stricts devaient être remplis. De nombreux sujets potentiels ont ainsi dû être refusés, car les valeurs de correction existantes des lunettes actuelles ne devaient s'écarter que légèrement des nouvelles valeurs mesurées.
Le contexte de l'étude est la classification des anomalies de la vision binoculaire non strabique utilisée jusqu'à aujourd'hui, proposée par A. Duane en 1896 (DUANE, 1896) et complétée en 1915 par les classes d'accommodation (DUANE, 1915). Des fréquences élevées d'anomalies non strabiques sont trouvées dans des études randomisées : 32 % chez des étudiants universitaires (GARCÍA-MUÑOZ ; et al., 2016), 32 % chez des patients adultes d'une clinique ophtalmologique (FRANCO et al., 2022) et 30 % chez des enfants et adolescents dans le sud de l'Inde (HUSSAINDEEN ; RAKSHIT et al., 2017). Les classes indiquent si les problèmes sont causés soit par la coopération binoculaire soit par l'accommodation. Au fil du temps, ces classes ont été largement conservées et n'ont été que légèrement étendues, comme par exemple par Scheiman et Wick avec leur "analyse intégrative". La répartition en 9 classes distinctes permet une intervention spécifique lorsque la performance visuelle est réduite malgré des yeux sains et que les tâches visuelles quotidiennes entraînent une gêne subjective. Les interventions possibles seraient alors, par exemple, des lunettes de correction avec des suppléments pour la vision de près et des prismes ou un entraînement visuel. Cependant, le concept est également remis en question, car les personnes appartenant à l'une ou l'autre de ces classes peuvent également ne pas présenter de troubles (CACHO-MARTÍNEZ ; et al., 2014).
Notre propre étude a trouvé une fréquence des anomalies d'environ 17 % chez les 100 sujets symptomatiques. Nous avons constaté certains défis lors de l'évaluation : Des erreurs peuvent facilement survenir lors du transfert des valeurs mesurées, inscrites à la main sur des protocoles de test, dans le tableau de données. Afin de garantir l'exactitude de toutes les données, nous avons vérifié nos données trois fois au total à différents moments. Lors de l'évaluation, nous suivons une voie qui n'a pas encore été décrite dans la littérature : nous établissons une programmation de la logique d'évaluation pour la détermination détaillée du statut afin d'éviter les erreurs d'évaluation manuelles. Les critères nécessaires à cet effet ont été assez bien décrits dans certaines études, mais nulle part de manière complète. On peut donc en déduire que la logique d'évaluation n'a pas été pensée jusqu'au bout dans des études comparables. Lorsque l'on évalue à la main, l'expérience clinique est importante pour le regroupement des données afin d'obtenir des résultats fiables. Mais en même temps, il existe un risque d'erreur qui est difficilement calculable. Nous sommes impatients de connaître nos résultats et nous essaierons de les finaliser en 2025. Nous ne manquerons pas d'en rendre compte ici aussi.
Développements prévus
Au sein du groupe de travail sur la vision binoculaire de l'Institut d'optométrie, nous avons déjà élaboré un premier plan pour examiner les anomalies binoculaires et accommodatives de 700 écoliers du primaire dans le cadre d'une étude à grande échelle. L'un des principaux objectifs est de déterminer la fréquence des problèmes visuels non strabiques chez les écoliers en Suisse. En outre, les mesures de toutes les fonctions visuelles importantes nous permettent de déterminer nos propres valeurs normatives et de calculer une batterie de tests très spécifiques, à l'instar de l'étude menée dans le sud de l'Inde. Ces connaissances scientifiques constituent à nos yeux une base nécessaire pour introduire un dépistage des particularités non strabiques dans toutes les écoles primaires. Nous préparerions ainsi le terrain pour que les enfants scolarisés ayant des problèmes de vue soient d'abord dépistés et ensuite envoyés au bon endroit pour être soignés. En tant qu'institution de recherche à but non lucratif, l'Institut d'optométrie est un acteur crédible. L'objectif d'information et de sensibilisation du public suisse mentionné au début pourrait ainsi faire un grand pas en avant. En particulier, les problèmes visuels des enfants en âge scolaire, qui sont fréquents et rarement détectés, bénéficieraient d'une attention particulière. Ainsi, avec le temps, de plus en plus d'enfants bénéficieront d'une correction de leurs anomalies non strabiques. L'expérience de la frustration en matière de lecture et de l'échec dû aux troubles visuels existants pourrait être épargnée à nombre de ces enfants. Lorsque ce point sera atteint, plus personne ne pourra comprendre pourquoi, pendant des décennies, si peu de choses ont été faites pour dépister ces problèmes de vision.
L'étude prévue s'étendrait sur deux ou trois ans et coûterait environ 250 000 CHF, le début le plus tôt possible pourrait être l'année 2026. Une coopération avec des spécialistes des hautes écoles pédagogiques et de la recherche en matière de santé est indispensable pour un projet d'une telle envergure. Les évaluations automatisées de l'étude sur les adultes seront utiles, car exactement les mêmes mesures sont effectuées chez les enfants. Notre expérience en matière de mesures optométriques et de gestion des données est également un atout pour mener à bien cette étude. Pour le financement, des discussions sont prévues avec des fondations et avec les acteurs importants de l'optométrie en Suisse. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de votre soutien éventuel, de vos suggestions ou de vos questions : volkhard.schroth@fhnw.ch.
Littérature :
CACHO-MARTÍNEZ, P. ; GARCÍA-MUÑOZ, Á. ; RUIZ-CANTERO, M. T. Existe-t-il des preuves de la validité des critères de diagnostic utilisés pour les dysfonctionnements binoculaires accommodatifs et non strabiques ? J Optom, 7, n. 1, p. 2-21, 2014 Jan-Mar 2014.
DUANE, A. A new classification of the motor anomalies of the eye : based on physiological principles, together with their symptoms, diagnosis, and treatment. New York : Vail, J.H., 1896.
DUANE, A. Anomalies de l'accommodation considérées cliniquement. Transactions of the American Ophthalmological Society, 14, n. Pt 1, 1915 1915.
FRANCO, S. ; MOREIRA, A. ; FERNANDES, A. ; BAPTISTA, A. Accommodative and binocular vision dysfunctions in a Portuguese clinical population. Journal of Optometry, 15, n. 4, p. 271-277, 2022.
GARCÍA-MUÑOZ, Á. ; CARBONELL-BONETE, S. ; CANTÓ-CERDÁN, M. ; CACHO-MARTÍNEZ, P. Dysfonctionnements accommodatifs et binoculaires : prévalence dans un échantillon randomisé d'étudiants universitaires. Clinical & experimental optometry, 99, n. 4, 2016 Jul 2016.
HOWARD, I. P. Percevoir en profondeur, Volume 1 : Mécanismes de base. New York : Oxford University Press, USA, 2012. 9780199764143.
HUSSAINDEEN, J. R. ; RAKSHIT, A. ; SINGH, N. K. ; GEORGE, R. et al. Prevalence of non-strabismic anomalies of binocular vision in Tamil Nadu : report 2 of BAND study. Clin Exp Optom, 100, n. 6, p. 642-648, Nov 2017.
HUSSAINDEEN, J. R. ; RAKSHIT, A. ; SINGH, N. K. ; SWAMINATHAN, M. et al. The minimum test battery to screen for binocular vision anomalies : report 3 of the BAND study. Clin Exp Optom, 101, n. 2, p. 281-287, Mar 2018.
HUSSAINDEEN, J. R. G., R ; Swaminathan, M ; et al. Binocular vision anomalies and normative data (BAND) in Tamil Nadu - study design and methods. Vis Dev Rehabil, 1, p. 260-271, 2015.
MAN, M. ; WICK, B. Gestion clinique de la vision binoculaire. Philadelphie : Wolters Kluwer. Lippincott Williams & Williams, 2020. 9781496399755.